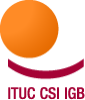Selon Claudine Akakpo, secrétaire générale adjointe de la CSTT (1), des centaines de milliers d’enfants sont contraints à l’esclavage domestique au Togo. Le mouvement syndical se mobilise contre ces exploitations.
La question du travail domestique reçoit enfin une attention sur le plan mondial, avec notamment la discussion de juin 2010 à la Conférence internationale du travail. Comment se présente ce secteur au Togo ?
Il fait partie de l’économie informelle. Beaucoup de migrantes internes quittent les régions rurales pour venir travailler dans les grandes villes. Le recrutement de travailleurs domestiques s’effectue notamment par le système du « confiage », dans lequel un parent ou un intermédiaire vient confier un enfant à un proche ou à une autre personne beaucoup plus aisée, à Lomé ou dans une autre grande ville. On trouve des enfants âgés d’à peine cinq ou six ans dans ce système. Ils ne perçoivent pas de salaire direct, c’est le parent ou l’intermédiaire qui vient prendre l’argent puis va le donner à la famille. Celle-ci ne se préoccupe pas vraiment des conditions très difficiles dans lesquelles les enfants vivent à Lomé.
Les salaires les plus bas sont de 5.000 francs CFA (environ 8 euros/mois). Comme ils habitent chez l’employeur, ils peuvent être employés 24 heures sur 24. Beaucoup doivent se réveiller à 4 heures du matin et sont les derniers à se coucher. Ils sont sans cesse à la tâche : laver le sol, la vaisselle, aller au marché, faire la cuisine, …On les appelle des « bonnes à tout faire » car elles font vraiment tout. On dit qu’elles logent chez l’employeur, mais si celui-ci a sa propre chambre, l’enfant n’a qu’une natte ou un pagne qu’il ou elle étend dans un coin de la de cuisine pour dormir… Etre logé, ce n’est pas ça ! C’est une forme d’esclavage puisque l’enfant ne reçoit pas de salaire direct. Nous avons vu des photos d’enfants qui ont été brûlés, cisaillés avec de petits couteaux, c’est l’horreur.
On trouve également des adultes qui viennent d’elles-mêmes chercher un emploi de domestique. Leurs conditions de travail sont dures, mais nous sommes davantage préoccupés par les très jeunes enfants à qui on impose ces exploitations terribles.
Combien d’enfants sont-ils dans cette situation ?
Des ONG comme Care International ont mené des enquêtes. Rien que pour Lomé, on estime le nombre à 250.000 enfants, dont une majorité de filles.
Le gouvernement togolais lutte-t-il contre ces exploitations ?
Le ministère de l’Action sociale est en train de mener une campagne : dès que l’on soupçonne une maltraitance d’enfant dans un domicile, on peut appeler le 111 et le ministère débarque pour mener des enquêtes. Notre syndicat collabore avec le ministère dans cette campagne, appelée « Allo 111 ». Elle a généré beaucoup de dénonciations, des centaines d’appels par jour depuis tout le Togo. Quand les autorités trouvent un enfant maltraité dans un foyer, elles font tout pour retrouver sa famille d’origine, celle-ci peut recevoir une aide pour soutenir l’enfant si c’est la pauvreté qui l’a poussée à mettre l’enfant en esclavage.
Y a-t-il des sanctions pour les partenaires de ce genre de trafic ?
Pour le moment, nous sommes à l’étape de la sensibilisation. Les sanctions viendront peut-être dans une deuxième phase, il faudra punir à la fois les parents qui mettent leurs enfants en esclavage et les employeurs. Nous avons une loi contre le travail et le trafic des enfants, mais il n’y a pas encore eu de procès pour des trafics internes. Par contre, il y a eu des jugements en ce qui concerne le trafic transfrontalier.
Quelles actions les syndicats togolais mènent-ils contre ces exploitations extrêmes d’enfants ?
Nous sensibilisons les parents qui acceptent ce genre de chose, tant à Lomé que dans les zones d’origine. Ce fut le cas notamment lors de la dernière journée sur le travail décent du 7 octobre. Nous leur montrons des photos et des vidéos pour qu’ils voient à quel point leurs enfants vont souffrir à Lomé et qu’ils ne les y envoient plus. Parfois, ils invoquent leur pauvreté, mais on leur répond que si c’était la seule cause, tous les pauvres enverraient leurs enfants au travail, or ce n’est pas le cas. Il faut qu’ils aient plus de dignité par rapport à eux-mêmes pour pouvoir respecter aussi les droits de ces enfants, comme le droit à l’éducation. Le BIT veut mettre en place un projet en association avec des syndicats et ONG pour qu’on puisse identifier ces parents, leur donner de petits prêts consacrés à des activités génératrices de revenus. Ils ne pourront donc plus invoquer la pauvreté comme raison d’envoyer leurs enfants dans le système de « confiage ».
Cette situation trouve ses racines dans le passé, dans un système traditionnel qui était meilleur : des parents moins aisés plaçaient leurs enfants chez ceux qui sont plus aisés, ceux-ci les mettaient à l’école et, en retour, les enfants effectuaient de menus travaux domestiques. Ce système traditionnel a été complètement dénaturé. Les employeurs en profitent, ils ne donnent pas le salaire à l’enfant, ils promettent parfois d’inscrire l’enfant à l’école mais ne le font pas, il n’y a plus aucune réglementation.
Il est probable que des employeurs figurent aussi parmi vos membres…
Oui. Lors de nos sensibilisations, on leur dit que les enfants travaillant chez eux ont des droits, comme le repos hebdomadaire. Ils sont parfois étonnés d’apprendre que les bonnes ont droit à un repos et que ce jour-là, ce sont eux-mêmes qui doivent travailler ! C’est difficile de les convaincre car pour eux, il est normal qu’un enfant présent dans leur domicile travaille et qu’ils puissent le corriger comme leurs propres enfants. C’est de là que vient la maltraitance. On frappe moins son propre enfant qu’un enfant domestique, qui est parfois puni avec un fouet ou des objets tranchants.
L’adoption éventuelle d’une convention internationale sur le travail domestique vous aiderait-elle dans votre action au Togo ?
Elle peut nous aider sur différents aspects. Tout d’abord, en redéfinissant l’âge minimum pour faire ce genre de travail. Il est de 18 ans au Togo, mais comme le travail domestique est actuellement dans l’économie informelle, il n’est pas réglementé par le gouvernement.
Ce sont des emplois précaires. A la moindre faute, une travailleuse domestique peut être renvoyée. Elles ne sont pas protégées par les lois garantissant le salaire minimum, le repos hebdomadaire, des indemnités en cas de licenciement.
Une norme internationale peut aussi nous aider sur la question du salaire. Actuellement, les travailleuses domestiques ne reçoivent pas le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti). Quand nous sensibilisons nos militants, ils répondent que s’ils sont obligés de payer le salaire minimum à l’employée domestique, ils doivent recevoir eux-mêmes des salaires plus élevés, car ils ne peuvent pas consacrer la moitié de leur propre salaire à celui de l’employée domestique. Nous essayons de leur faire comprendre que s’ils n’ont pas les moyens d’avoir une travailleuse domestique à la maison, ils doivent remplir ces tâches eux-mêmes. C’est un problème délicat car si les personnes qui ne peuvent payer le salaire minimum abandonnent leurs travailleuses domestiques, que vont-elles devenir ? Nous ne voulons pas retrouver ces filles à la rue, dans la prostitution, en train de voler, …
De façon plus générale, quelles sont les priorités de votre syndicat au niveau de l’égalité des genres ?
Les filles togolaises sont souvent privées d’éducation car on privilégie traditionnellement celle des garçons. Sans formation, beaucoup de femmes doivent se réfugier dans l’économie informelle, là où l’on trouve la précarité, les salaires insuffisants, l’absence de protection sociale. Nous avons des programmes qui les aident à trouver des activités génératrices de revenus complémentaires, nous les formons aussi à la gestion de leurs activités commerciales. Pour palier l’absence de protection sociale, nous avons mis en place des mutuelles de santé. Ce n’est pas facile car notre mentalité ne nous pousse pas à prévoir le lendemain, on vit au jour le jour. Comme pour un système d’assurance, on ne sent pas le besoin d’adhérer à cette mutuelle de santé, ce n’est qu’une fois confrontés à la difficulté qu’on en reconnaît les bienfaits. Notre centrale compte plus de 100.000 membres, mais à peine 2.000 adhèrent à la mutuelle.
Y a-t-il une grande différence de salaire entre travailleurs et travailleuses au Togo?
Sur le plan légal, il n’existe aucune discrimination mais au niveau de l’imposition des revenus, les impôts d’une travailleuse sont supérieurs à ceux de son mari car nous avons un Code de la personne et de la famille selon lequel l’épouse est une personne à charge. Cette différence se retrouve également au niveau des allocations familiales : comme une femme est une personne à charge, elle ne bénéficie pas d’allocations familiales si son mari ne lui en donne pas l’autorisation, alors qu’il y a droit automatiquement. Ces différences d’imposition et d’allocations familiales peuvent engendrer une différence de près de 15% entre le salaire réel des travailleurs et des travailleuses qui ont le même grade.
Est-il plus difficile pour une femme de grimper dans la hiérarchie du travail ?
Oui, et ça vient d’abord d’un problème de mentalité. Dans le secteur où je travaille, la communication, il n’y a pas de femme rédactrice en chef. Il a fallu attendre 2006 pour voir une femme nommée directrice d’un organe de presse. Sur une trentaine de directions de la communication, à peine cinq postes à responsabilités ont été confiés à des femmes. Cette difficulté des femmes d’accéder à la hiérarchie se reflète sur le plan politique : il y a à peine sept femmes sur un parlement de 81 députés et, au niveau du gouvernement, il n’y a que quatre femmes sur une vingtaine de postes.
Qu’en est-il au niveau syndical ?
Sur les six centrales syndicales, aucune n’a une femme comme secrétaire général mais au niveau de ma confédération, on essaye d’évoluer vers un certain équilibre. Nous sommes deux femmes secrétaires générales adjointes, et nous faisons partie des quatre femmes présentes parmi les 17 membres du bureau exécutif. Il y a un tiers de femmes parmi nos 100.000 adhérents.
Vous étiez l’une des déléguées à la Conférence mondiale des femmes de la CSI (2), dont l’un des thèmes était la lutte contre la violence envers les femmes. Qu’en est-il au Togo ?
Nous déplorons du harcèlement sexuel dans beaucoup de lieux de travail. En tant que syndicats, nous essayons de sensibiliser les auteurs d’harcèlement, mais il n’y a pas encore eu de procès qui permette de les dénoncer, d’en parler largement dans les médias. Il n’existe même pas de loi contre le harcèlement. Il y a une loi contre le viol et l’inceste, mais rien de plus, il faut donc attendre que l’auteur aille au-delà du harcèlement pour l’attaquer !
Que retirez-vous de cette conférence ?
Elle a montré que les problèmes des Togolaises sont vécus par de nombreuses femmes dans le monde, j’ai beaucoup appris en écoutant comment d’autres luttent contre les violences faites aux femmes. C’était encourageant d’entendre une responsable de l’OIT nous parler de ce qui se prépare dans le futur en faveur des enfants domestiques, pour qu’on puisse les sortir de ces exploitations et que les adultes obtiennent un travail décent. J’ai aussi apprécié la sensibilisation au changement climatique lors de cette Conférence. C’est un phénomène crucial et chez nous, les syndicats n’ont pas encore pris ce problème à bras-le-corps alors qu’il nous menace tous, travailleurs ou pas.
Propos recueillis par Samuel Grumiau
(1) Confédération syndicale des travailleurs du Togo. Claudine Akakpo est également chargée des questions de genre, d’équité et des affaires féminines au sein de la CSTT.
(2) La première Conférence mondiale des femmes de la CSI s’est tenue à Bruxelles du 19 au 21 octobre 2009, sur le thème « Un travail décent, une vie décente pour les femmes »