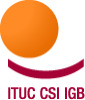Pourquoi l’économie informelle et les syndicats
La condition des travailleurs dans l’économie informelle a, depuis toujours, représenté un défi pour les syndicats et toutes les personnes engagées dans la défense des droits humains et des travailleurs. Un défi difficile à relever, et ce pour maintes raisons : De la carence de statistiques fiables à la nature éparse et fragmentée des activités informelles, outre la grande diversité d’activités, sans parler du fait que dans beaucoup de régions, le travail informel a été étiqueté comme illégal et, partant, punissable. Aussi le défi et le paradoxe pour le mouvement syndical réside-t-il dans le fait que l’économie informelle soit considérée « marginale » ou « marginalisée » alors-même qu’elle représente une part majoritaire de l’ensemble du marché du travail, et ce tant dans les zones urbaines que rurales.
Dans les pays à revenu plus élevé comme dans les pays les plus pauvres, cela implique que des réponses doivent être apportées au nombre croissant de personnes travaillant en marge du système structuré ou formel du travail salarié, exposées aux risques, exerçant des emplois précaires, dépourvues de sécurité sociale et, surtout, des personnes qui n’arrivent plus à se figurer et à concevoir un avenir. Sur ce terrain commun, il est possible d’envisager la construction d’un véritable partenariat, fondé sur une connaissance approfondie des différents contextes spécifiques.
Si un syndicat parvient à relever ces défis en offrant organisation, protection sociale et droits aux travailleurs de l’économie informelle, la définition-même de ce que constitue un syndicat des travailleurs pourrait changer du tout au tout.
Un document officiel publié en Éthiopie en 2011 indique : « La récession économique, les politiques d’ajustement et les taux élevés soutenus d’urbanisation et de croissance démographique se trouvent à l’origine d’une expansion aussi inattendue qu’inédite du secteur informel dans nombre de pays en développement, et ce à mesure que les entreprises des secteurs modernes et, a fortiori, celles du secteur public, se sont vues contraintes de licencier des travailleurs ou de réduire les salaires de façon drastique… preuve en est le fait qu’en Éthiopie 50,6 pour cent des sans-emploi en milieu urbain travaillent dans l’économie informelle. » Secteur où les femmes sont surreprésentées en Éthiopie comme partout ailleurs.
Les statistiques macroéconomiques, quant à elles, permettent de relever une contradiction. D’une part, une croissance du PIB de 11%, un indice de développement humain (IDH) en rapide progression et, de l’autre, le 173e rang occupé par le pays sur les 187 pays repris dans ce même indice. Ceci peut s’expliquer, en partie, par le niveau initial déjà très faible mais aussi en raison de la dimension du secteur informel qui a été, et demeure, « invisible » dans les statistiques. Donner de la « visibilité » au secteur informel implique, dès lors, bien plus que le simple fait d’en relever l’existence.
D’autre part, le système de protection sociale du pays est le plus vaste d’Afrique. Mais bien que le gouvernement éthiopien ait investi 70 du budget national en 2011-2012 dans des programmes de réduction de la pauvreté, aucun résultat visible n’a été enregistré.
Comment les syndicats peuvent-ils relever le défi de la « syndicalisation » et de la « représentation » des travailleurs (et femmes travailleuses) dans l’EI ainsi que celui des nouveaux marchés du travail émergents ? Il s’agit, en premier lieu, de savoir qui sont les travailleurs informels, quelles sont les différences entre eux, quelles contraintes ils affrontent, et s’ils sont ou non pris en charge dans le cadre du régime de régularisation mis sur pied par le gouvernement. Les résultats de l’étude serviront de base à l’élaboration d’un programme pilote qui pourrait suggérer de nouvelles politiques dans le cadre d’un modèle de développement centré sur le travail et la promotion des droits sociaux et économiques.
Pourquoi les femmes ?
Les marchés du travail se féminisent de plus en plus. « Les trois dernières décennies ont vu une participation croissante des femmes dans l’économie mondiale mais l’on a assisté, dans le même temps, à une érosion soutenue des droits des travailleurs. » Comme il a été relevé dans maintes études, c’est dans l’économie informelle que se concentre la majorité des femmes et des pauvres, or c’est aussi à ce niveau que les efforts des instances officielles en matière de protection sociale laissent à désirer. Le ministère éthiopien des Affaires féminines a identifié l’autonomisation économique des femmes comme sa principale priorité, alors que toutes les autres agences internationales du pays (de la Banque mondiale à l’UNICEF et jusqu’aux ONG internationales et aux pays individuels, dont la Suède, le Canada et l’Italie notamment) soutiennent des programmes s’adressant aux femmes à titre individuel en leur offrant des plans d’épargne et de crédit.
Le gouvernement éthiopien a élaboré un programme extrêmement ambitieux de régularisation du travail informel. Celui-ci prévoit des campagnes de porte-à-porte, l’enregistrement des travailleurs informels illégaux en tant que « demandeurs d’emploi », la création de groupes de cinq membres, l’épargne groupée obligatoire, l’accès au crédit et, le cas échéant, la mise à disposition gratuite de locaux commerciaux pour une période de cinq ans, jusqu’à ce que l’entreprise ait « fait ses preuves ». Les femmes figurent au cœur de ce programme qui a été examiné de façon détaillée par l’étude, et ce dans trois districts : Addis-Abeba (banlieue de Kolfe Keranio), Jimma et Hawassa [1].
Résultats de l’étude
Deux groupes de femmes ont répondu au questionnaire (296 sondées au total) : Un premier groupe réunissant des anciennes travailleuses informelles actuellement organisées dans le cadre de micro- et petites entreprises (MPE) et un second groupe réunissant des femmes encore actives dans l’économie informelle. Plus de deux tiers (68%) des participantes étaient des migrantes. Addis-Abeba affichait le plus haut pourcentage de migrantes (74%), suivi d’Hawassa (68%) et de Jimma (60%). Un tiers des participantes étaient analphabètes et la majorité des travailleuses informelles non déclarées appartenaient à des ménages dont elles n’étaient pas la seule source de revenu. Seul environ un cinquième des femmes qui espéraient un jour démarrer une nouvelle activité disposaient du capital nécessaire à cette fin (16% des femmes travaillaient au régime de PME à titre individuel, 23% dans des PME collectives et 20% dans l’informel). Le manque de sécurité matérielle, de fonds de roulement et de possibilités d’emploi dans le secteur formel, la concurrence avec les plus grands vendeurs et le manque d’accès à l’eau courante propre figuraient parmi les principaux défis. (Tilahun Girma )
La régularisation des activités informelles suffit-elle en soi pour « sortir les travailleurs de la pauvreté » ?
Les entretiens approfondis menés dans le cadre de l’étude (Davide Chinigò) ont montré l’existence de différents groupes identifiés par la place qu’ils occupent, de l’informel au formel, dans la cartographie des entreprises. De ceux qui ne sont pas en mesure d’introduire des demandes de licence ou de payer des impôts (parfois appelés les « informels tolérés », vu la nature illicite des entreprises informelles) et qui sont ciblés dans le cadre de l’un ou l’autre programme de soutien (ou d’assistance) à ceux qui figurent dans une « liste d’attente » d’aide à l’emploi, en passant par les « légaux formels » auxquels le gouvernement octroie u espace (terrain ou magasin) pour y exercer des activités formelles sujettes à des licences et aux impôts. Différents systèmes de crédit assortis de modalités de garantie diverses ont été examinés (groupe, famille, amis, voire responsables auprès du département chargé des PE). Si les dix dernières années ont vu le nombre de PE dans les trois districts concernés se multiplier à un rythme soutenu, un certain nombre d’obstacles et de contraintes ont néanmoins été relevées : 1) Certaines femmes refusent de faire des emprunts car elles ne veulent pas s’endetter. 2) Les femmes ont tendance à dépenser le montant du prêt sur les frais de ménage dès l’obtention du prêt. 3) Dans certains contextes, les femmes ont affirmé qu’elles préféraient épargner à la Banque de commerce (plutôt que dans une institution de micro-finance) ou par le biais d’autres instruments d’épargne, afin de pouvoir disposer de l’argent lorsqu’elles en ont besoin.
Bien que le programme de régularisation s’inscrive dans la lignée politique de l’épargne d’abord, c’est-à-dire en inculquant le réflexe de l’épargne à travers des formations, les contraintes, elles, sont dérivées du cercle vicieux de la pauvreté : La peur du risque chez les personnes qui sont « trop pauvres pour épargner ». Par ailleurs, ou conséquemment à cela, la situation de l’immense majorité des petites entreprises que nous avons vues pourrait être décrite comme guère mieux que « stagnante », et ce malgré le fait qu’elles aient été démarrées 6 ou 7 ans auparavant.
Plus le secteur informel s’étend, plus la protection sociale devient problématique, comme le montre le recours qui est fait aux emprunts. Pour l’heure (bien qu’une évaluation soit peut-être précoce à ce stade) il est possible d’affirmer que la micro-finance peut empêcher un déclin vers une pauvreté accrue mais pas qu’elle puisse conduire de la pauvreté à la croissance. Existe-t-il une issue à ces contraintes ?
Les coopératives peuvent-elles offrir une solution ?
L’étude a examiné le cas des coopératives de femmes en Éthiopie (Cecilia Navarra) comme une voie possible pour mettre à niveau les petites entreprises et garantir une viabilité relative assortie d’une protection sociale. La fragmentation de l’activité indépendante et de l’entrepreneuriat et leur désavantage concurrentiel dans le contexte de marchés en évolution pourraient les aider à trouver une force nouvelle dans l’organisation de chaînes de valeur sous forme de coopératives. Ce qui implique qu’un accès au marché doive être garanti pour de telles entreprises, du moins durant la phase initiale, et à titre provisoire. Les coopératives en Éthiopie sont soumises aux dispositions du Décret 147/1998 de 2004 ; celui-ci stipule qu’elles sont tenues de respecter les principes de l’affiliation ouverte et du suffrage démocratique, de répartir les dividendes entre les membres en fonction des parts que ceux-ci détiennent, après avoir placé 30% des bénéfices dans des fonds d’épargne ou les avoir consacrés à la création d’emplois ou à des fins sociales. Les coopératives de crédit sont une forme d’institution désormais répandue tant dans les zones urbaines (SACCO) que dans les zones rurales (RUSACCO) et semblent remplir différentes fonctions, notamment par le rôle important qu’elles jouent dans les politiques sociales, dès lors que les gens peuvent recourir à des emprunts en cas de difficulté économique. Le principal handicap des SACCO se situe au niveau de la taille des prêts, qui sont excessivement réduits et limités en fonction du montant de l’épargne. Le succès d’une coopérative ayant pour mission de renforcer la profitabilité des petites entreprises semble tributaire de deux facteurs : 1) Sa capacité d’intégration dans la chaîne des valeurs et, 2) L’identification d’un accès au marché sûr et stable. Bien que conscientes de l’incidence de ces deux questions primordiales sur la réussite d’une coopérative, les femmes ne peuvent se permettre de renoncer au recours aux emprunts comme alternative à la protection sociale. Attendu que toutes les femmes interrogées dans le cadre de l’étude ont une expérience à la fois des groupes de « solidarité » gérés selon l’approche traditionnelle et des groupes d’entreprise tournés vers la génération de revenu, les conditions pourraient être réunies pour l’expérimentation d’un modèle où les deux systèmes fusionneraient éventuellement.
Autonomisation à l’initiative et protection sociale
À l’heure d’examiner les résultats de l’étude, il nous incombe de rappeler le sens originel du terme « autonomisation » (Gabriella Rossetti) lorsque celui-ci fait référence aux femmes, dès lors que l’objectif premier de ces programmes est, de fait, énoncé comme étant « l’autonomisation économique des femmes ». Nous avons réalisé qu’il était impossible d’isoler une dimension particulière de la vie des femmes des autres – pas même la dimension économique – et que l’initiative et la voix des femmes sont des conditions sine qua non pour garantir tout changement réel, c’est-à-dire un processus transformatif des relations hommes-femmes à tous les échelons de la société. Nous avons vu des femmes négocier le budget ménager au sein de leur famille, des femmes engagées à assumer la responsabilité sociale de la scolarisation de leurs enfants et même de garantir un abri aux membres de leurs familles. Ces femmes, celles trop pauvres pour épargner, demandent avant tout une sécurité et une protection sociale, tel qu’il est démontré par le recours qu’elles font aux petits prêts qu’elles sont en mesure d’obtenir, alors qu’un travail salarié pourrait constituer la seule réponse viable à leurs besoins. Dans certains cas, des initiatives de travaux publics et d’emplois publics ont été créées non sans un certain succès. Le choix politique posé par le gouvernement éthiopien, à savoir d’investir dans des mesures/initiatives collectives, la stratégie consistant à privilégier la constitution de groupes plutôt que d’investir dans des activités individuelles, évoquent l’importance d’une « voix » collective capable de réclamer des droits. Celle-là-même qui s’articulera sous forme de coopératives de chaînes de valeur. Toutefois, cette transition des groupes vers une voix « collective » ne doit pas être considérée comme allant de soi. Cela implique davantage que le simple fait de « constituer des groupes » et des coopératives efficaces. La question posée par beaucoup d’auteurs d’études consacrées à l’économie informelle est la suivante : « Qu’est-ce qui motive les travailleurs de l’économie informelle à entreprendre une action collective en leur propre nom (vu le risque potentiel que cela implique pour leur emploi et leurs moyens d’existence) ? » Cette question nous renvoie à une prise en considération plus large de toutes les questions soulevées par cette étude. La réponse fournie traditionnellement par les syndicats est la suivante : L’organisation et la représentation. Mais étant donné que l’organisation constitue un outil et non un moyen en tant que tel, elle n’est efficace qu’à partir du moment où elle se développe depuis l’intérieur d’une collectivité sociale, comme une facette du processus d’autonomisation. Un tel processus ne peut survenir en vase clos et requiert, au contraire, l’existence d’un contexte social et politique « propice ». Et c’est là une tâche à laquelle les syndicats pourraient contribuer en prônant une approche de développement centrée sur le travail et l’emploi, ce qui exigerait des politiques aussi bien que des programmes et pourrait commencer par un soutien à toutes les formes possibles d’auto-organisation, en particulier celles dédiées à la production et au contrôle de la protection sociale. Relever ce défi est une mission qui concerne de près aussi bien les syndicats éthiopiens qu’italiens.
Gabriella Rossetti
Au nom de l’équipe de recherche NEXUS/CETU : Cecilia Navarra, Tilahun Girma, Davide Chinigò