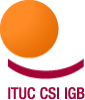La Fédération générale palestinienne des syndicats (PGFTU)s’est fortement engagée avec l’Autorité palestinienne pour la reconnaissance par les Nations Unies d’un Etat palestinien. Shaher Sa’ed, son secrétaire général, s’en explique et expose les dossiers sur lesquels il est urgent selon lui d’avancer pour améliorer les conditions de vie des travailleurs palestiniens. Au premier rang : lutter pour un salaire minimum et une véritable protection sociale.
En quoi la bataille politique menée par l’Autorité palestinienne pour la reconnaissance d’un Etat concerne le syndicat que vous dirigez ?
La réponse est simple. Sans démocratie, sans la possibilité de construire un Etat moderne, il ne peut y avoir de droits pour les travailleurs. La reconnaissance de notre droit inaliénable à disposer de nous-mêmes est un préalable au développement économique et social, à l’émergence de cette véritable législation du travail que nous appelons de nos vœux. Croyez-moi, lorsque, chaque matin, votre esprit est concentrer sur la crainte que vous pouvez avoir de ne pouvoir passer un check point, vous avez parfois du mal à vous mobiliser pour un code du travail qui garantirait vos droits devant les employeurs. Votre préoccupation est d’une autre nature... Sans Etat, sans sécurité, de quel avenir les Palestiniens peuvent-ils se prévaloir ?
Si le dossier avance, quelles seraient les premières revendications que vous exposeriez au gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des Palestiniens ?
Les besoins sont énormes, ne serait-ce qu’en matière de protection contres les accidents du travail. Les droits en la matière sont quasi inexistants. Je pourrais aussi parler des congés, des arrêts maladies. En tous ces domaines, nous sommes encore très loin de l’application de ce principe de « travail décent » que réclame le mouvement syndical international. Beaucoup de choses restent à gagner donc mais deux dossiers, à nos yeux, sont prioritaires : l’établissement d’un salaire minimum et l’émergence d’un véritable système de protection sociale. Ces deux sujets sont intimement liés car sans protection sociale il n’est pas possible de défendre les revenus. Et sans un niveau de salaire décent, il n’est pas possible de créer un système de protection sociale. Actuellement, dans les deux cas, les travailleurs palestiniens ne disposent d’aucun droit. Depuis des années, nous tentons de traiter le sujet dans le cadre des négociations tripartites que nous avons avec les employeurs et l’Autorité palestinienne. En 2004, nous étions sur le point d’aboutir pour l’établissement d’un système de sécurité sociale mais la Banque mondiale nous a obligés à geler l’ensemble du dossier.
Pour quelles raisons la Banque mondiale s’y est-elle opposée ?
La loi que nous étions sur le point de voter ne lui convenait pas. Elle ne correspondait pas à ses standards... La Banque mondiale s’inquiétait des moyens que nous avions de financer notre projet. Nous lui avons répondu, nous avons argumenté. Le système que nous proposions était financé. Elle n’a rien voulu entendre. Il y a trois ans, nous avons demandé que des discussions reprennent sur le sujet. Elles sont en cours. Le dossier doit avancer. Il le doit au risque sinon d’enfoncer la population palestinienne dans le dénuement. Nous avons besoin de l’aide du BIT. Nous avons besoin qu’il nous conseille et nous aide à faire pression sur l’Autorité palestinienne pour avancer. La fondation d’un système tripartite et indépendant de protection sociale est fondamentale pour garantir des droits aux travailleurs. Elle est d’autant plus urgente que des compagnies privées apparaissent sur le marché pour proposer leurs services.
Quel niveau de salaire minimum revendiquez-vous ?
Sans un revenu égal minimum à 2 500 shekels (500 euros), nul ne peut vivre décemment en Palestine. Ce niveau est celui que nous demandons. Nous menons campagne actuellement pour cela et nous aimerions avoir une réponse à ce sujet lors de notre prochain congrès, en décembre prochain.
Pensez-vous que l’économie palestinienne est en mesure de supporter ce niveau de revenu ?
Il ne peut y avoir de démocratie sans justice. Aujourd’hui, beaucoup de femmes, lorsqu’elles travaillent, gagnent moins de 1 000 shekels par mois (200 euros). Cette situation n’est pas tenable. A condition de retrouver notre liberté, de disposer d’une continuité territoriale en Gaza et la Cisjordanie, de pouvoir maîtriser nos frontières, nous avons les moyens de notre développement. Nous avons des richesses agricoles : de l’huile d’olive en Cisjordanie, des fruits, des légumes, des fleurs à Gaza. Notre terre, nos villes, offrent comme à Bethléem, Jérusalem ou Jéricho un formidable réservoir d’opportunités pour le tourisme. Nous avons aussi une industrie de la pierre qui intéresse le monde entier. Nous exportons jusqu’en Chine et aux Etats-Unis. A condition de disposer d’un Etat, de pouvoir circuler et nous déplacer, l’économie palestinienne est viable. Nous avions des industries, des entreprises qui étaient capables de supporter la concurrence. Elles ont été détruites par l’armée israélienne, nous pouvons les reconstruire. Ouvert, le marché intérieur palestinien permettrait d’écouler une production qui souffre aujourd’hui des check points et de l’impossibilité que nous avons de commercer entre Gaza et la Cisjordanie. La Palestine n’est pas condamnée au chômage et au sous-développement. Les Palestiniens ont un niveau de formation et d’éducation de haut niveau qui leur permettrait de construire une économie moderne, un Etat démocratique garantissant les droits du travail et les droits sociaux, respectant les conventions internationales du OIT. Nous n’avons pas de pétrole mais nous avons les moyens de nous développer comme tout autre pays en Europe ou ailleurs.
Régulièrement des projets de zones franches sont avancés sur le territoire palestinien. Quelle approche avez-vous de ce sujet ?
Nous n’y sommes pas opposés à condition que l’on y respecte le droit. Mais, à ce jour, plus aucune zone franche n’existe en Palestine. En 2000, deux mille personnes étaient encore employés à Erez, à la frontière entre Gaza et Israël. Cette zone a été totalement détruite par l’armée israélienne. Celle qui devait exister à côté de Jénine ne fonctionne pas… Les zones franches aujourd’hui sont dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, et elles ne cessent de se développer. En 2000, 10 000 personnes y travaillaient. Aujourd’hui, 35 000 y travaillent dans des conditions inacceptables, où les employeurs respectent au gré de leurs besoins les droits qui les intéressent : parfois le droit israélien, parfois le droit palestinien, parfois le droit jordanien. Ce n’est pas de cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin que les travailleurs palestiniens puissent trouver du travail ailleurs que dans les colonies ou en Israël.
Que peut-on proposer aux jeunes diplômés fortement touchés par le chômage en Palestine aussi ? Avez-vous des revendications particulières les concernant ?
C’est un sujet de préoccupation évident. Chaque année, près de 35 000 d’entre eux sortent du système éducatif sans avoir de perspectives, seuls 4 000 à 5 000 d’entre eux pouvant espérer entrer dans les services de l’Autorité palestinienne. Près de 40% des moins de 25 ans sont au chômage aujourd’hui en Palestine. Partir, immigrer, tenter de trouver un emploi en Israël : telles sont ces temps-ci leur unique perspective. C’est aussi leur avenir qui se décide avec la création ou non d’un Etat palestinien. Et c’est pour eux et leurs parents que nous ne cesserons de militer pour que cet acte devienne réalité, que nous participerons à toutes les discussions qui pourront se tenir avec les employeurs et avec l’Autorité pour en préciser les contours.
Propos recueillis par Martine Hassoun